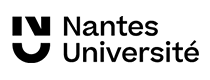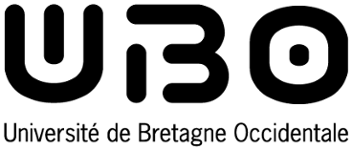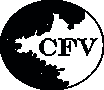Axe 3. Artefacts et systèmes
Travaux consacrés à des objets dont l'identité est marquée par une interaction avec l'homme ou à des dispositifs complexes pouvant intégrer une dimension organisationnelle et sociale (l'espace portuaire comme système technique complexe, le végétal modifié comme artefact).
Techniques, méthodes et terrains en recherche et pratique cliniques
Responsables : Mathilde Lancelot et Stéphane Tirard
Autre participant·e·s du Centre François Viète : Lydie Bichet, Miranda Boldrini, Clémence Guillermain, Armelle Grenouilloux, Océane Fiant.
Participant·e·s extérieur.e.s : Giulia Anichini, Philippe Bizouarn, Sonia Desmoulin, Paul Véron
Plusieurs programmes de recherche composent ce sous axe, qui se répartissent ainsi :
II) Programmes sur les techniques, méthodes et expériences vécues issues des pratiques cliniques
I) Programmes sur les techniques et méthodes en recherche clinique :
- Réseau DataSanté (depuis 2023)
Issu du programme DataSanté (2017-2022), le réseau DataSanté est désormais intégré au cluster ELIT de Next et est partenaire des programmes de recherche de sciences cliniques suivants :
- Programme Mitomics, Mitochondrial Disease database: An integrated multi-OMICS approach, coordonné par Vincent Procaccio, professeur à l’Université d’Angers et responsable du service de génétique du CHU d’Angers.
Les travaux d'analyse épistémologique de la démarche engagée dans ce programme ont été confiés à Clémence Guillermain, post-doctorante à la MSH Ange-Guépin et au Centre François Viète.
- FHU GenoMedS, Génétique Omiques Médecine et Société.
II) Programmes sur les techniques, méthodes et expériences vécues issues des pratiques cliniques
- LivACT (2024-2029) - Living and ageing with chronic conditions and technological devices : Meanings, Practices and Recompositions of Autonomy through time. (coord. : L. Dalibert). Financement ANR PPR Autonomie, France 2030, 23-PAVH-0003. Co-coordination WP1 (M. Lancelot, T. Danaila) "Chronic living and ageing with technology". Post-doctorante au Centre François Viète sur le projet : Lydie Bichet
- RHU5 PRIMUS (2022-2027) Projection In Multiple Sclerosis. Transformation de la prise en charge des patients atteints de Sclérose en plaques grâce à un outil d'aide à la décision médicale fondé sur des données multidimensionnelles. (coord. : G. Edan). Financement PIA, France 2030, ANR-21-RHUS-0014.
Au sein du WP6 (coord. D. Laplaud) « Study of multiple impacts of CDSS use: Real-world usage for real-world evidence », un travail d’analyse de l’implémentation et de la réception d’un CDSS en clinique, et dans le cadre d’un essai clinique, sera réalisé de manière pluridisciplinaire à compter du printemps 2025 (coord. : M.Lancelot, E. Leray et S. Desmoulin)
Post-doctorante au Centre François Viète sur le projet : Miranda Boldrini
- Projet Etude de l'outil algorithmique d'aide à la décision médicale MS Vista - financé par la Fondation ARSEP (2022-2024) - 1263 dans le cadre de l'Appel 2021 "Approche personnalisée, éthique, sociologique et économique de la Sclérose en plaques par la recherche" (coord. M. Lancelot – Post-doctorante : G. Anichini)
Le projet entendait examiner les enjeux épistémologiques, philosophiques et éthiques liés à l’utilisation d’algorithmes à base d’apprentissage automatique (machine learning) dans la prise en charge de la Sclérose en Plaques (SEP). Pour ce faire, nous nous sommes focalisés sur l’étude d’un dispositif en cours de développement industriel : MS Vista, un algorithme d’aide à la décision médicale à base de ML. L’objectif de ce dispositif est de permettre une anticipation précise et personnalisée de la « trajectoire de maladie » de patients atteints de SEP, et ceci par l’exploitation de données issues de sources multiples (situations thérapeutiques réelles, essais cliniques). Cette recherche a été partenaire du programme RHU PRIMUS.
Énergies, techniques et sociétés
Responsable : Anaël Marrec
Participant·e·s du Centre François Viète : Hugo Doux, Gaëtan Fustec, Adèle Huguet, Gaëtan Levillain, Fabien Mahé, Anaël Marrec, Paul Naegel, Pierre Teissier.
Le programme Energies, techniques, sociétés, analyse des objets techniques dans leurs dimensions politiques, sociales, matérielles et culturelles en Europe depuis le XVIIIe siècle. Soucieux des enjeux contemporains de la recherche en histoire et inscrits dans des réseaux dynamiques, ses participant.e.s donnent une place de premier plan aux dimensions globales et environnementales des techniques. Particulièrement actif.ve.s sur la thématique de l'énergie, ses chercheur.e.s examinent des espaces sociaux et des secteurs économiques aussi variés que les mers et rivières, les territoires agricoles, les forêts. Une première approche examine les convertisseurs énergétiques, au plus près des techniques et de leurs acteurs (ingénieurs, inventeurs, praticiens) : machines thermiques et électriques, piles à combustible, énergies renouvelables. Une seconde approche porte sur les changements techniques, les ressorts politiques et sociaux de ces choix, et les conflits auxquels ils donnent lieu à différentes échelles: mobilisations anti-nucléaires, conflits d'industrialisation et de désindustrialisation, propositions d'alternatives. Enfin, une dernière perspective aborde la gestion et l'impact environnemental des ressources et des pollutions (bois, eau, sols, déchets).
Projets financés
Le projet ANR Estuer intègre ces trois perspectives, en collaboration interdisciplinaire avec des collègues nantais en géographie, sociologie, sciences politiques.Thèses en cours
- Huguet, Adèle, Transitions énergétiques et histoire de l'agriculture en France (1940-présent). De la "pétrolisation" au "reverdissement" de l'agriculture. Codirection : Jean-Baptiste Bahers, Pierre Teissier.
- Levillain, Gaëtan, L’enrésinement des forêts et l’industrialisation du bois en France (XIXe-XXe siècles) : une histoire technologique, culturelle et environnementale de la redéfinition d’un matériau traditionnel. Codirection : Stéphane Tirard, Pierre Teissier & Christophe Bonneuil (Centre Alexandre Koyré, Paris).
Thèses récemment soutenues
- Fustec, Gaëtan, Histoire de la gouvernance des communs dans l’habitat participatif. Direction : Stéphane Tirard.
- Robineau, Didier, L'introduction de l'électricité dans la marine militaire 1880-1935, thèse de doctorat sous la direction de Martine Acerra et Jean-Louis Kerouanton, soutenue à l'Université de Nantes en mai 2019.
- Martin, Philippe, Histoire de l'industrie des engrais dans l'estuaire de la Loire à l'époque contemporaine, thèse de doctorat sous la direction de Jean-Louis Kerouanton et Stéphane Tirard, soutenue à l'Université de Nantes en septembre 2018.
- Marrec, Anaël, Histoire des énergies renouvelables en France, 1880-1990, thèse de doctorat sous la direction de Dominique Pécaud et Pierre Teissier, soutenue en septembre 2018 à l'Université de Nantes.
Stages/Mémoires de master
- Hugo Doux. Sujet : histoire des pollutions des sols à l'époque contemporaine dans l'estuaire de la Loire. Financement : Projet ANR Estuer.
- Fabien Mahé. Sujet : histoire des voitures électriques à l'époque contemporaine. Financement : Projet ANR Estuer.
Dernières publications sur le sujet
- Anaël Marrec, Mahdi Khelfaoui, "Energy in the History of Technology", in Guillaume Carnino, Jérôme Lamy, Liliane Hilaire-Perez, Global History of Techniques, Brepols, 2024.
- Gaëtan Levillain, "Quand l’industrie fait feu de tout bois : persistance du bois en Europe et redéfinition des frontières extractives (1913-2020)", Histoire et mesure, Vol. 38, n°3, 2023, p. 187-222.
- Anaël Marrec, "Synergies et persistances dans l'histoire des techniques de l'énergie", Dossier des Cahiers François Viète, Vol. III, n°12, 2022. Voir le numéro en ligne
- Sarah Claire & Anaël Marrec (éds)., Mémoire et énergie, numéro spécial Socio-anthropologie (2020), vol. 42. Voir le numéro en ligne sur le site de la revue.
- Anaël Marrec & Pierre Teissier, « Les énergies alternatives... Face aux politiques conservatrices », in François Jarrige et Alexis Vrignon (dir), Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives et renouvelables à l'âge industriel, Paris, La Découverte, 2020.
- Étienne Delaire & PIerre Teissier, « Horizons, chaînes et rivages frigorifiques en France, 1900-1930. Marchés alimentaires, modernités techniques et pêches industrielles », Cahiers François Viète, Université de Nantes, 2020, Rivages et horizons techniques des mondes atlantiques au vingtième siècle, III (8), p. 51-90 (téléchargeable sur HAL-SHS)
- Pierre Teissier & Anaël Marrec, « Usage des métaphores en histoire de l’énergie : de la dynamique du point à la psychologie des nénuphars », Artefact. Techniques, Histoire et Sciences humaines, vol. 11, décembre 2019, p. 309-339 (téléchargeable sur le site de la revue).
- Marrec Anaël, « Les îles industrielles, une idée récurrente dans l'histoire de l'énergie ? », in Lamard, Pierre & Stoskopf, Nicolas (dir), La transition énergétique, un concept historique ? Septentrion, 2018, p. 177-196.
- Teissier Pierre, “From the Birth of Fuel Cells to the Utopia of the Hydrogen World”, in B. Bensaude-Vincent, S. Loeve, A. Nordmann and A. Schwarz (eds.), Research Objects in their Technological Setting, London & New York, Routledge, 2017, p. 70-86.
Projets en cours
- Appel à articles pour la revue Flux : "Les utopies techniques" (Fanny Lopez, Anaël Marrec, Olivier Coutard). Lien vers l'appel.
Lieux de savoirs : institutions et territoires
A - Nanthématiques : mathématiques et mathématicien·nes nantais·es à l'époque contemporaine
Responsables : Jenny Boucard et Colette Le Lay
Participant·e·s : Anne Boyé, Anne-Sandrine Paumier, Thomas Préveraud (Laboratoire de mathématiques de Lens), Norbert Verdier (GHDSO, Orsay)
L'objectif de ce projet est d'interroger le développement des mathématiques dans la région nantaise à l'époque contemporaine (second XVIIIe siècle - XXe siècle). Au-delà de sa position géographique, une spécificité nantaise est l'absence d'université entre la Révolution française et les années 1960. Quels sont alors les lieux et les modalités des mathématiques nantaises durant cette période ? L'impact de la (re)création de l’université de Nantes sera aussi étudié. Ce projet fait écho aux différents travaux sur les offres locales d'enseignement (voir par exemple le séminaire organisé par le GHDSO et le programme Maths in Metz) et vise à participer à l'établissement d'une histoire locale et sociale des mathématiques pour la région nantaise, en croisant notamment des approches institutionnelles, géographiques, prosopographiques, biographiques. Actuellement, trois axes sont travaillés dans le cadre de ce projet.
- Quelles mathématiques pour quels publics à Nantes avant la recréation de l’université ? Un premier objectif de cette partie est de produire une prosopographie des acteur·ices nantais liés aux mathématiques et de dresser une cartographie des mathématiques nantaises pour la période 1750-1950. Pour cela, nous nous appuyons notamment sur les archives locales, la presse nantaise, les travaux historiens sur l’université de Nantes, ainsi que sur plusieurs bases de données prosopographiques et de périodiques mathématiques.
- Création et transformation d’un lieu mathématique à la Faculté des Sciences de Nantes : du « service de mathématiques » au « laboratoire de mathématiques Jean Leray » (1960’-2010’). Ce travail actuellement mené par Jenny Boucard et Anne-Sandrine Paumier vise à étudier la place de l’enseignement et de la recherche en mathématiques au sein de l’université de Nantes dans le second XXe siècle et de la constitution d’un laboratoire de recherche. Nous analysons comment une communauté de mathématicien·nes s’est progressivement organisée et intégrée dans son environnement local, régional et national et la manière dont un service d’enseignement des mathématiques s’est progressivement transformé en un laboratoire de recherche. Nous nous appuyons pour cela sur les archives universitaires disponibles et une série d’entretiens effectués avec des mathématicien·nes du laboratoire Jean Leray. L’analyse de ces entretiens permettra de poser la question d’une éventuelle mémoire collective propre au laboratoire, et des effets induits sur les souvenirs des témoins interrogés.
- Éditeurs et éditions mathématiques à Nantes (période contemporaine)
Responsable : Jean-Luc Le Cam
Notre approche de l’histoire de l’éducation et des savoirs fait une large place à la recherche des éléments explicatifs extérieurs aux instances institutionnelles et à leur production normative ou aux seules logiques internes des champs disciplinaires en construction. Elle intègre les déterminants économiques, sociaux, culturels ou religieux et cherche à comprendre comment ces éléments interagissent, avec les contraintes fonctionnelles, pour faire système. D’où l’emploi du concept heuristique d’écosystème, appliqué aux systèmes scolaires et universitaires, pour expliquer leur dynamique ou leur stabilité sous l’action combinée de forces et d’acteurs.
Nous l’appliquons sur différents objets de recherche et plusieurs aspects du système scolaire et universitaire.
Description plus détaillée du programme
Histoire des paysages industriels et maritimes
A - Histoire et patrimoine des Paysages Industriels Culturels Sensoriels (PICS)
Responsables : Sylvain Laubé (CFV et CERV) et Ronan Querrec (CERV/LabSTICC)
Laboratoires partenaires : Lab-STICC (UMR 6285), CERV (Centre Européen de Réalité Virtuelle), Musée des Arts et Métiers-CNAM, FEMTO-ST/RECITS (UMR 6174)/UTBM, LS2N (UMR CNRS 6004)/Ecole Centrale de Nantes, MSH-LE, CREDA (UMR 7227)/Paris Sorbonne Nouvelle
Participants : Isabelle Astic (CNAM/MAM), Marina Gasnier (FEMTO), Jean-Louis Kerouanton, Florent Laroche (LS2N), Sylvain Laubé, Mylène Pardoën (MSH-LE), Ronan Querrec (CERV), Nicolas Richard (CREDA), Marie-Morgane Abiven, Nathan Godet (doctorant CRIHAM, université de Poitiers), Pierre Mahieux (doctorant ENIB/CERV)
Présentation complète du programme et de son séminaire sur la page dédiée.
Responsable : Hervé Ferrière
- Risques et aléas (pollutions marines)
- Sciences et droit de la mer
Voir la description de cette thématique, qui s'inscrit majoritairement dans l'axe 1 « Concepts et théorie ».
C - Les humanités numériques appliquées à l'étude comparative de l'impact urbain et régional de la modernisation technologique des ports d'outre-mer de France et d'Argentine (ECOS-Sud)
Responsable : Bruno Rohou, chercheur associé au Centre François Viète
Institutions impliquées : Centre Viète-UBO & Instituto de Estudios Históricos Económicos Sociales e Internacionales (IDEHESI, Argentine)
Recherche soutenue par le programme de mobilité ECOS-Sud (depuis mars 2019)
Le projet a deux objectifs. Le premier est de produire des études historiques comparatives visant à promouvoir la conservation et la valorisation des paysages culturels portuaires dans le cadre de la science participative. Le second objectif est d'apporter une aide à la décision pour les opérateurs des zones portuaires dans la gestion de leur patrimoine et sa valorisation d'un point de vue socio-économique.
Événement à venir :
Organisation du 6e Colloque international sur le patrimoine portuaire du 20 au 22 octobre 2021 à Campana, Province de Buenos Aires, Argentine.
Publications récentes :
Bruno Rohou, Miguel de Marco, Gustavo Chalier & Martin Petersen, « Modernisation de rivages techniques entre l’Argentine et la France : les ports de Rosario, Arroyo Pareja, Mar del Plata et Quequén (1900-1930) », Cahiers François Viète (2020), III-8, p. 91-116.